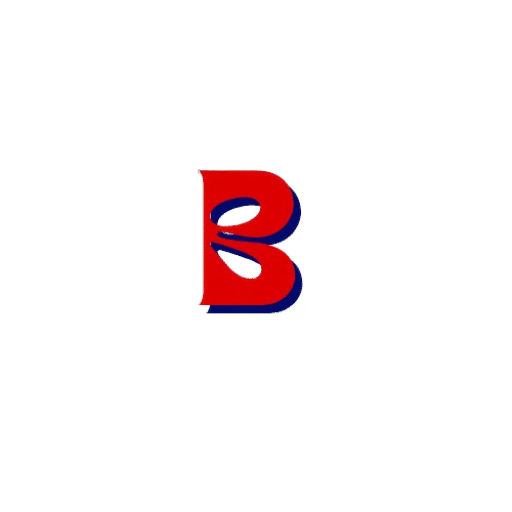Dans un pays où la violence des gangs, l’instabilité politique et les catastrophes naturelles se conjuguent pour plonger la population dans une crise humanitaire sans précédent, les organisations humanitaires internationales trouvent, dans cette insécurité un terrain fertile pour justifier et amplifier leur présence. Alors que Haïti s’enfonce dans une spirale de violence, avec plus de 1,3 million de déplacés internes et 5,4 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë, ces organisations jouent un rôle crucial, mais leur impact et leurs motivations suscitent des débats.
Une crise humanitaire d’une ampleur colossale
Depuis plusieurs années, Haïti est confrontée à une montée exponentielle de la violence, principalement orchestrée par des gangs armés qui contrôlent la majorité des quartiers de la capitale, Port-au-Prince, et s’étendent désormais aux régions rurales comme l’Artibonite, le Centre et bien d’autres. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 700 000 personnes ont fui leurs foyers en 2024, un chiffre en hausse de 22 % par rapport à juin de la même année. À cela s’ajoute une insécurité alimentaire touchant près de la moitié de la population, soit 5,4 millions d’Haïtiens, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). Les services de santé et d’éducation, déjà fragiles, se sont effondrés dans de nombreuses zones.
Cette crise multidimensionnelle a créé un vide que les organisations humanitaires internationales s’efforcent de combler. L’OIM, par exemple, a fourni plus de 6 millions de litres d’eau potable et des soins psychosociaux à des dizaines de milliers de déplacés depuis février 2024. De son côté, le PAM soutient plus d’un demi-million d’enfants à travers des programmes de repas scolaires, tout en achetant localement 70 % des produits pour stimuler l’économie haïtienne. Des ONG comme ALIMA et SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se sont également mobilisées, mettant en place des cliniques mobiles, des distributions de kits sanitaires et des réponses ciblées, souvent en collaboration avec des acteurs locaux.
L’insécurité, un moteur pour l’action humanitaire
Si l’insécurité paralyse la vie quotidienne des Haïtiens, elle constitue paradoxalement un levier pour les organisations humanitaires. La gravité de la situation attire l’attention internationale et justifie des appels de fonds massifs. Cette année, le Plan de réponse humanitaire de l’ONU pour Haïti, évalué à 908 millions de dollars, vise à soutenir 3,9 millions de personnes. Cependant, ce plan reste dramatiquement sous-financé, avec seulement 8 % des fonds nécessaires reçus à mi-parcours de l’année, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Ce manque de financement, couplé à l’urgence des besoins, renforce la légitimité des ONG à intervenir, souvent en se substituant à un État haïtien affaibli.
L’insécurité a également conduit à la mise en place de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), dirigée par le Kenya et soutenue par l’ONU. Bien que son déploiement soit lent et entravé par des pénuries de personnel et d’équipement, cette mission offre un cadre opérationnel aux organisations humanitaires, qui bénéficient d’une protection accrue pour accéder aux zones les plus dangereuses. Par exemple, ALIMA, en partenariat avec une ONG haïtienne, a lancé en 2024 une mission d’urgence à Port-au-Prince, ciblant les populations déplacées dans des camps de fortune où l’accès est un défi majeur.
Un rôle controversé : entre aide vitale et dépendance
Cependant, l’omniprésence des organisations humanitaires soulève des questions. Haïti, souvent surnommée la « république des ONG », dépend fortement de l’aide internationale depuis des décennies. En 2010, après le séisme dévastateur, l’aide humanitaire représentait près de la moitié du PIB du pays, injectant entre 2 et 3 milliards de dollars dans l’économie. Si cette aide a sauvé des vies, elle a aussi créé une dépendance structurelle, critiquée pour avoir affaibli l’État haïtien. Comme le soulignait en 2010 le représentant de l’Organisation des États américains, « s’il existe une preuve de l’échec de l’aide internationale, c’est Haïti, où la communauté internationale a le sentiment de devoir refaire chaque jour ce qu’elle a terminé la veille ».
Les perceptions de l’insécurité varient également entre les acteurs. Une étude du Groupe URD en 2013 a révélé des divergences marquées entre les organisations humanitaires, qui adoptent souvent des mesures sécuritaires strictes, et les ONG de développement, plus enclines à travailler avec les communautés locales. Ces différences compliquent la coordination et alimentent les critiques sur l’efficacité de l’aide. De plus, l’insécurité alimentaire et les violences sexuelles, particulièrement contre les femmes et les filles dans les camps de déplacés, soulignent les limites des interventions humanitaires face à des défis systémiques.
Vers une approche durable ?
Face à cette crise, les organisations humanitaires internationales doivent naviguer entre l’urgence de l’action et la nécessité de solutions à long terme. Le PAM, par exemple, insiste sur l’importance de s’attaquer aux causes structurelles de la faim, tandis qu’ALIMA met l’accent sur le renforcement des capacités locales pour une réponse plus ancrée. Pourtant, sans un soutien international accru à la MMSS et une stabilisation politique, les efforts humanitaires risquent de rester palliatifs.
En conclusion, l’insécurité en Haïti, bien qu’elle aggrave les souffrances de la population, constitue un catalyseur pour l’action des organisations humanitaires internationales. Leur présence est indispensable, mais leur impact dépendra de leur capacité à collaborer avec les acteurs locaux, à renforcer l’État haïtien et à sortir du cycle de dépendance. Comme l’a souligné Waanja Kaaria, représentante du PAM en Haïti, « l’attention internationale doit rester focalisée sur Haïti ». Mais au-delà de l’urgence, c’est une vision d’avenir, portée par les Haïtiens eux-mêmes, qui permettra de briser la spirale de la crise.